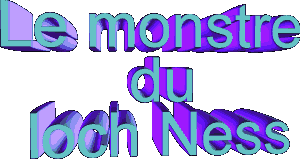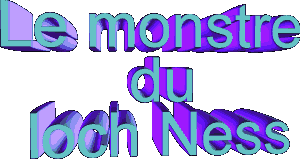| L'affaire de Nessie a été le prétexte à l'affrontement de deux traditions antagonistes issues
des Lumières. La première, que l'on peut considérer comme un naturalisme modéré, s'est efforcée de réduire la question à une accumulation d'illusions visuelles: Les nombreux témoins auraient été abusés par le manège d'animaux aquatiques, le jeu des vagues, les tromperies des mirages. L'autre tradition, considère que le lac des Highlands recèle une colonie d'animaux non répertoriés. La première approche, privilégiée par l'institution scientifique, tend à disqualifier la légende; La seconde n'en retient que les éléments compatibles à une intégration du monstre dans le champ d'une zoologie conjecturale. Mais l'existence de créatures aquatiques extraordinaires n'a pu être établie. Selon Roy Mackal, le loch Ness aurait été le site d'observations étranges réparties sur mille quatre cents ans. Dans son livre (The Monsters of Loch Ness), le cryptozoologue rassemble ces observations. Tout commence par l'histoire de saint Columba qui, en l'an 565, aurait miraculeusement sauvé un de ses disciples menacés par un monstre dans la rivière Ness, qui relie le loch à la mer du Nord. Ce récit, qui mêle naturel et surnaturel dans un but d'édification, n'a acquis aujourd'hui de l'intérêt qu'en raison de sa localisation. Mackal assume une continuité pourtant démentie par sa propre liste. D'après lui, le second témoin par ordre chronologique serait un certain Mac kenzie, en... 1871 ! En fait, ce rapport n'a été connu qu'en 1933, à la suite de la vague d'intérêt suscitée par Nessie. Aucune chronique médiévale, aucun texte de la Renaissance ou du XVIIe siècle ne signale la présence d'une créature inconnue dans les eaux du loch. Au siècledes Lumières, les Highlands s'ouvrent aux curieux des secrets de la nature. Le naturaliste Thomas Pennant les parcourt, recueillantes données qui trouveront place dans sa British Zoologie C1776 sans mentionner une quelconque anomalie à propos de la faune lacustre écossaise. Nessie ne daigne pas faire surface lors des bouleversements de l'écosystème consécutifs au creusement, entre 1804 et 1822, du canal Calédonien. Elle n'effraie aucun des nombreux touristes qui, autour de 1873, empruntent l'un des six. steamers transportant quotidiennement les voyageurs d'un bout à l'autre du lac. Pourtant, les victoriens sont de grands amateurs de monstres, et les vulgarisateurs, quand ils ne régalent pas leurs lecteurs des dernières cabrioles du serpent de mer, n'hésitent pas à évoquer les curieuses créatures des lointains lacs islandais. Nessie ne
s'exhibe en fait qu'à partir de la première moitié du XXe siècle, en un lieu d'où la crise de 1929 a fait fuir les touristes.
|